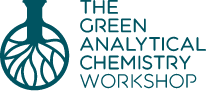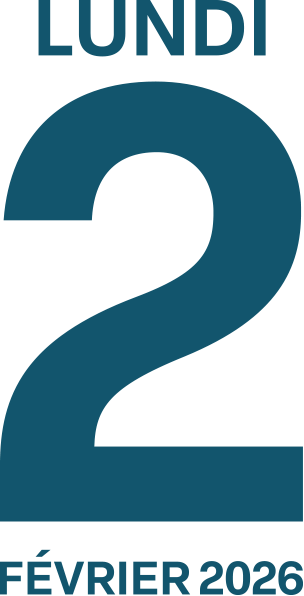09h55 - 10h20
40 ans d'innovation dans la préparation d'échantillons écologiques au RIC
Tatiana CUCU - RIC technologies / Belgique
En savoir plus
La préparation des échantillons joue un rôle crucial dans les analyses chromatographiques
et influence fortement la qualité, la fiabilité et l'interprétabilité des résultats obtenus.
Première étape essentielle, elle conditionne la récupération de l'analyte, la sélectivité et la
réduction de la matrice, influençant ainsi la performance globale des méthodes analytiques
plus que toute autre étape du flux de travail. Ces dernières décennies, le domaine a évolué,
passant de procédures laborieuses et consommatrices de solvants à des approches plus
rapides, plus propres et plus efficaces. Cette transition a été motivée par le besoin d'un débit
d'échantillons plus élevé, d'une meilleure répétabilité et reproductibilité, et d'un impact
environnemental réduit. Les techniques de préparation d'échantillons miniaturisées et
automatisées se sont imposées comme des solutions performantes, offrant une sensibilité
accrue tout en réduisant considérablement la consommation de solvants et d'échantillons.
Parallèlement, l'intérêt croissant pour la chimie analytique verte a accéléré le
développement de nombreuses méthodologies durables, parmi lesquelles les techniques
d'extraction sans solvant telles que l'extraction par sorption sur barreau magnétique (SBSE).
De nombreuses technologies vertes ont démontré à maintes reprises leur capacité à fournir
des performances analytiques élevées, associées à des limites de détection très basses et à
une quantification améliorée. Des applications principalement développées pour l'analyse
GC entièrement automatisée seront sélectionnées pour illustrer les performances
exceptionnelles des analyses vertes.
09h30 - 09h55
Chimie analytique durable : comment la mettre en œuvre en R&D ?
Emmanuelle BICHON - Laberca / France
En savoir plus
Le changement climatique et le dépassement des limites planétaires nous obligent à nous demander comment nous pouvons poursuivre nos activités de recherche tout en intégrant ces concepts, ce cadre et ces contraintes.
Dans le domaine des sciences analytiques, de nouvelles compétences sont requises, notamment pour accompagner l’évolution des habitudes de travail des opérateurs jusqu’aux responsables des unités de recherche. Parallèlement, les caractéristiques acceptables d’une méthode analytique devraient être définies.
Plusieurs outils existent, comme ceux proposés par le collectif Labo 1.5, et des indicateurs en chimie analytique durable ont également émergé au cours des quinze dernières années. Cependant, il n’existe pas encore de véritable consensus sur une approche consolidée à ce stade. C’est pourquoi nous proposons dans notre travail une approche pragmatique de réduction de la consommation des ressources, comme action concrète et directe pour intégrer rapidement des changements d’habitudes allant de l’organisation du laboratoire à l’analyse.
Pour illustrer notre travail, plusieurs exemples seront présentés, de l’inventaire des gaz à effet de serre de notre plateforme de métabolomique à l’étude de chaque étape du processus analytique, de la taille de l’échantillon à la méthode analytique.
09h55 - 10h20
L'hexane, un risque sanitaire et réglementaire pour les produits alimentaires
et non alimentaires : son élimination des protocoles d'analyse peut améliorer
la protection des consommateurs
Laurence JACQUES - EcoXtract / France
En savoir plus
L’hexane, un risque sanitaire et réglementaire pour les produits alimentaires et non alimentaires : pourquoi l’élimination de l’hexane des protocoles analytiques peut améliorer la protection des consommateurs.
L’hexane, une essence de pétrole neurotoxique, suspectée reprotoxique et perturbatrice
endocrinienne, est, encore aujourd’hui, largement utilisée pour extraire les huiles alimentaires et les extraits naturels. L’extraction à l’hexane est, en effet, très efficace et très rentable. Cependant, son utilisation contamine les produits extraits et les produits des animaux nourris avec des produits extraits. Les huiles, arômes, parfums, les protéines ou le cacao dégraissé, les œufs, le beurre, les ingrédients cosmétiques ou les produits nutraceutiques se retrouvent chargés en résidus. L’EFSA, l’Autorité de Sécurité des Aliments en Europe a publié un rapport en septembre 2024,
reconnaissant que la protection du public n’était pas assurée et qu’il fallait réexaminer l’autorisation alimentaire de l’hexane. Cet examen a démarré en mai 2025 et ses conclusions sont attendues pour novembre 2027.
Par ailleurs, l’hexane est entré, en février 2025, dans la liste d’intention des Substances Très
Préoccupantes, la liste noire des produits chimiques en Europe. Les substances qui rentrent dans cette liste ont vocation à être interdites sous quelques années en Europe. Enfin, en mars 2025, le député MODEM Richard Ramos a déposé un projet de loi à l’Assemblée Nationale pour imposer la traçabilité de l’hexane puis son élimination progressive.
C’est la détection de résidus d’hexane dans les produits du quotidien qui a contribué à la
mobilisation des politiques et des acteurs de la société civile. Quels sont les niveaux de résidus d’hexane mesurables dans les produits alimentaires et non alimentaires ? L’hexane est aujourd’hui encore utilisé pour de très nombreux protocoles de laboratoire. L’ubiquité
de ce polluant, dans de nombreuses plateformes analytiques est un obstacle, dans certains cas pour développer des méthodes avec de meilleures limites de détection. Cette difficulté, couplée à l’entrée de l’hexane dans la liste des substances très préoccupantes, la liste noire des produits chimiques, pose la question de la substitution de l’hexane dans les protocoles de laboratoire.Quelles sont les alternatives à l’hexane aujourd’hui disponibles ? Comment évoluer vers des méthodes d’analyses plus vertes ?
10h20 - 10h45
Application cosmétique des solvants eutectiques profonds naturels :
opportunités et défis
Benoît CAPRIN - Gattefossé / France
En savoir plus
Depuis leur introduction, les solvants eutectiques profonds naturels (NADES) sont apparus comme une alternative prometteuse et respectueuse de l’environnement aux produits pétrochimiques pour dissoudre les métabolites végétaux.[1] Alors que la demande de cosmétiques durables et écologiques ne cesse de croître, ces solvants offrent des opportunités encore inexplorées pour développer des extraits innovants dotés d’empreintes phytochimiques et d’activités biologiques uniques. Cependant, malgré le nombre de NADES décrits dans la littérature, seuls quelques-uns peuvent réellement être utilisés à des fins cosmétiques en raison de questions de sécurité ou de réglementation.[2,3]
Cette présentation commencera par une introduction au cadre réglementaire et aux exigences de la chimie verte auxquelles doivent répondre les ingrédients actifs cosmétiques. Dans un second temps, la stratégie choisie par Gattefossé pour développer, caractériser et industrialiser des solvants et des procédés d’extraction répondant aux contraintes cosmétiques sera détaillée. La valeur ajoutée des NaDES par rapport aux solvants d’extraction traditionnels, en termes de composition phytochimique et d’efficacité biologique, sera discutée à travers des exemples concrets.[2,3]
Enfin, cette conférence vise à démontrer comment les contraintes d’un domaine spécifique peuvent être surmontées et transformées en opportunités. Forts de cette expérience dans l’industrie cosmétique, nous ouvrirons un débat sur les perspectives offertes dans le domaine de la chimie analytique.
11h15 - 11h40
L'avènement de la chromatographie liquide multidimensionnelle.
Combler le fossé entre la recherche et les méthodes d'analyse modernes
Gerd VANHOENACKER - RIC technologies / Belgique
En savoir plus
La chromatographie multidimensionnelle est extrêmement performante pour l'analyse complète d'échantillons complexes, offrant une capacité de pics considérablement améliorée, permettant la résolution et la quantification d'analytes autrement masqués par la matrice.
Si la chromatographie gazeuse bidimensionnelle (2D-GC) a gagné en maturité et s'est imposée dans divers flux de travail et industries, son implémentation dans les laboratoires d'analyse de routine a toujours été entravée par des difficultés de développement de méthodes, de configuration matérielle et de traitement des données.
Des avancées récentes et ciblées en matière de matériel et de logiciels de 2D-LC réduisent considérablement la complexité pour les utilisateurs non experts, permettant ainsi d'appliquer la technique en dehors du milieu universitaire et de la recherche fondamentale.
Les résultats présentés confirment la maturité opérationnelle de la 2D-LC moderne pour son intégration dans les flux de travail analytiques quotidiens, suscitant une discussion sur son rôle imminent d'outil standard dans les analyses de pointe.
11h40 - 12h05
Chromatographie analytique et préparative en fluide supercritique (SFC) :
Dans quelle mesure peut-elle être écologique ?
Caroline WEST - Institut de Chimie Organique et Analytique (ICOA) / Orléans, France
En savoir plus
La chromatographie en phase liquide supercritique (SFC) est une méthode de séparation ancienne et depuis longtemps privilégiée à des fins préparatives, notamment pour la résolution des énantiomères de médicaments. À l'échelle préparative, ses avantages par rapport à la chromatographie liquide en phase normale (NPLC) traditionnelle sont bien connus : résolution, productivité, économie d'énergie et de solvant sont les principaux arguments en faveur de la SFC.
À l'échelle analytique, la SFC a été acceptée plus récemment, grâce à l'introduction d'instruments améliorés et à une intégration facilitée à la spectrométrie de masse dans les années 2010. Les évolutions technologiques ont ainsi ouvert un large éventail d'applications, au-delà de l'analyse pharmaceutique traditionnelle, incluant les produits naturels, les matières plastiques ou l'analyse environnementale. Si l'économie de solvants est moins évidente dans un système analytique que dans un système préparatif, l'intérêt écologique de la SFC analytique peut néanmoins se manifester dans différents aspects de la méthode, notamment les solvants de phase mobile GRAS, la durabilité des colonnes ou l'économie de consommables avec les méthodes de préparation d'échantillons en ligne.
Dans cette présentation, les principales caractéristiques du SFC seront expliquées et plusieurs exemples seront fournis pour illustrer sa large applicabilité.
14h30 - 14h55
Électrophorèse capillaire : au-delà de la R&D, vers l’analyse à haut débit
avec une consommation chimique et production de déchets négligeable
Noah WEISS - Customer Analytical Services Lab (CASL), Veolia / Texas, États-Unis
En savoir plus
À quand remonte la dernière fois que vous avez vu un instrument d'électrophorèse capillaire (EC) fonctionner en laboratoire ? Dans les années 1990, l'analyse par EC a suscité un vif intérêt, notamment en raison de son potentiel révolutionnaire en sciences analytiques. Cet intérêt a largement disparu au XXIe siècle au profit des systèmes chromatographiques et de spectrométrie de masse. L'EC s'est forgé une réputation d'outil de recherche difficile à comprendre et peu reproductible, utile peut-être pour résoudre des problèmes académiques complexes, mais jamais devenu un élément clé des laboratoires de production.
Nous présentons ici le travail réalisé par notre laboratoire Veolia WTS pour surmonter certains défis liés à l'analyse par EC, ce qui lui a permis de devenir l'un de nos instruments les plus importants. Notre laboratoire analyse désormais environ 100 échantillons par semaine par EC, produisant plus de 20 résultats par échantillon en 10 minutes, et ce, pratiquement sans gaspillage chimique ni consommation de produits chimiques/consommables. La technologie s'est avérée si robuste et reproductible que Veolia WTS prend désormais en charge le déploiement d'analyseurs par EC sur les sites de ses clients, sur le terrain ou dans des laboratoires satellites plus petits. Cette présentation détaillera comment nous avons surmonté les difficultés suivantes pour parvenir à ce succès : (1) temps de migration décalés et non reproductibles, (2) détection UV pour les composés non actifs UV, (3) traitement des données complexe, et (4) co-élutions complexes et capacité de pic limitée. Les cibles analytiques présentées comprennent les composés aminés, les anions inorganiques et organiques, les polymères cationiques et certains métaux. Bien qu'il soit irréaliste que l'analyse CE puisse couvrir l'ensemble du spectre de l'analyse chimique, nous espérons que ces travaux démontreront que les scientifiques doivent prendre en compte plus souvent l'analyse CE lors du choix de méthodes analytiques répondant aux critères de la chimie analytique verte. Il est possible que l'engouement suscité dans les années 1990 ne soit pas encore pleinement concrétisé.
14h55 - 15h20
Développement d'une méthode de spectrométrie de masse ciblée DART-Triple
Quadrupôle sans chromatographie pour la détection rapide d'adultérants
dans le safran
Linda MONACI - Istituto di Biomembrane, Bioenergetica e Biotecnologie Molecolari (IBIOM) – CNR / Bari, Italie
En savoir plus
Dans cette note, nous décrivons le développement d'une méthode de criblage rapide, robuste et à haut débit pour la détection d'adultérants dans la poudre de carthame.
L'étude explore le potentiel de la méthode DART, combinée à une surveillance ciblée des réactions multiples (MRM), sur un spectromètre de masse triple quadripôle DART-EVOQ récemment lancé, pour la détection de quantités infimes de carthame et de curcuma dans le safran. Des expériences de balayage complet et de balayage des ions produits ont permis d'identifier des marqueurs potentiels ainsi que leurs transitions pour chaque adultérant avant de mettre en place des expériences de MRM pour l'analyse quantitative. L'ajout d'un étalon interne s'est avéré améliorer la linéarité de l'étalonnage et réduire la variabilité des mesures. Des courbes d'étalonnage appariées à la matrice ont été préparées dans du safran adultéré avec un pourcentage croissant de poudres bon marché adultérantes, et les courbes d'étalonnage ont montré une forte corrélation. La limite de détection (LD) et la limite de quantification (LOQ) ont finalement été calculées, prouvant que la méthode développée était capable de détecter de faibles quantités de curcuma et de carthame dans le safran, aussi faibles que 3 % et 5 % respectivement. Compte tenu de sa rapidité, de sa simplicité et de sa robustesse, cette méthode pourrait constituer un bon candidat pour une mise en œuvre systématique en laboratoire afin de détecter rapidement l'adultération du safran par le carthame ou le curcuma. Enfin, l'écologisation de la méthode a été évaluée à l'aide d'un logiciel dédié disponible en ligne, permettant ainsi de promouvoir le respect des principes de la chimie analytique écologique.
15h20 - 15h45
Monitoring des PFAS : Optimisation de la stratégie analytique par le screening
non ciblé et l'échantillonnage passif
Gaëla LEROY et Christophe TONDELIER - Veolia DEST (Direction des Expertises Scientifiques et Techniques) / France
En savoir plus
Les PFAS sont omniprésents et utilisés dans de multiples applications en raison de leurs propriétés chimiques. Ils sont tristement célèbres pour leur extrême stabilité et persistance dans les matrices environnementales. C’est pourquoi Veolia s'engage activement dans le traitement de ces substances dans diverses matrices, les plaçant au cœur de sa stratégie de dépollution.
L'impact des PFAS s'étend au petit cycle de l'eau. La contamination des eaux usées par les rejets industriels notamment peut conduire à la présence de PFAS dans les boues, ce qui peut restreindre leur épandage agricole. Par ailleurs, des rejets d'eaux contaminées peuvent polluer les ressources utilisées pour la production d'eau potable. Ainsi, de nombreuses études sont actuellement menées pour dépolluer les eaux contaminées par ces PFAS. Ces recherches explorent l'utilisation de matériaux ad/absorbants tels que les charbons et les résines, ou via des filières membranaires. Ce défi est accentué par un cadre réglementaire de plus en plus strict. En effet, actuellement, des listes limitées de substances sont recherchées en raison de limitations analytiques et de manque de connaissances. Toutefois, ces listes pourront s'élargir et inclure des paramètres plus étendus visant notamment le "total PFAS", dans certaines géographies.
Pour anticiper cette évolution, le département des expertises scientifiques et technologiques de Veolia mène des études approfondies sur la caractérisation des PFAS dans diverses matrices, développe des protocoles de mesure globale (fluor total), d’analyses ciblées et non ciblées. La présentation proposée vise à illustrer cette gestion de la contamination en PFAS, au travers de 2 projets de recherche, l’un axé sur la validation d’un échantillonneur passif dont l’objectif est de traquer une quarantaine de PFAS dans les réseaux d’assainissement afin d’en identifier les origines et proposer des actions ou solutions de réduction à la source. Cette validation implique le développement de méthodes d’analyses en chromatographie en phases liquides et gazeuses couplées à la spectrométrie de masse (LC-MS et GC-MS). Le second projet est complémentaire et vise à étendre les connaissances sur les PFAS par la mise en place d’une méthodologie de screening non ciblé (NTS : Non Targeted Screening). Cette approche est basée sur l’analyse par LC couplée à la MS haute résolution (LC-HRMS). Elle nécessite la mise en place de workflow complet de traitement de données. Cette démarche aide à identifier des PFAS aujourd’hui encore inconnus dans le but de pouvoir approfondir la caractérisation des contaminations.
16h15 - 16h40
De la complexité à la connaissance : analyse avancée
d'échantillons environnementaux
Caroline GAUCHOTTE-LINDSAY - Université de Glasgow / Royaume-Uni
En savoir plus
Les systèmes environnementaux sont chimiquement diversifiés, dynamiques et
souvent mal décrits par les analyses ciblées traditionnelles. Pour favoriser des prises
de décision plus écologiques et efficaces, nous avons besoin de méthodes
permettant d’extraire un maximum d’informations avec un minimum d’effort
analytique. Cette présentation introduit l’analyse de signatures comme concept
unificateur pour transformer des échantillons environnementaux complexes en
connaissances interprétables. Plutôt que de se concentrer sur des cibles prédéfinies,
les approches basées sur les signatures capturent l’empreinte physico-chimique
complète d’un échantillon, que ce soit par des techniques avancées de GC couplées
(TD-GC-MS et GC×GC-TOF-MS) ou par des réseaux de capteurs optiques conçus
pour imiter la perception holistique d’une “langue” artificielle. Ces signatures
deviennent puissantes lorsqu’elles sont associées à des méthodes chimiométriques
et des flux de travail d’apprentissage automatique, incluant le découpage des
caractéristiques, les statistiques multivariées et la reconnaissance de motifs non
supervisée. À travers une série d’exemples environnementaux, j’illustrerai comment
ces méthodes révèlent des processus à l’échelle du système.
En utilisant la TD-GC-MS, les signatures volatiles des fosses septiques productrices
de méthane donnent un aperçu de l’activité microbienne et de la stabilité
opérationnelle. Les empreintes GC×GC-TOF-MS des sols et eaux contaminés
révèlent les voies de biodégradation des hydrocarbures, capturant des transitions
inaccessibles aux méthodes ciblées.
J’introduirai également une “langue” optique, un réseau de capteurs
chimioplasmoniques où chaque élément réagit différemment à un mélange,
produisant un motif optique multidimensionnel analogue à un profil aromatique. Ces
signatures spectrales complexes ne peuvent être interprétées directement et
nécessitent l’apprentissage automatique pour être décodées, permettant des tâches
de classification extrêmement sensibles. À Carron Valley, la langue optique a
discriminé entre la géosmine et le 2-MIB durant un épisode de goût et d’odeur,
tandis que dans le bassin versant de la rivière Almond, elle a “goûté” des mélanges
de micropolluants pour inférer les pressions sur le bassin, même à de faibles
concentrations individuelles.
Dans le contexte de la chimie analytique verte, l’analyse de signatures favorise une
préparation minimale, maximise l’information par échantillon et accélère la
surveillance environnementale durable. En combinant des mesures avancées avec
une réduction intelligente des données, nous passons de la métrologie à la
signification, au service de systèmes d’eau et de sol plus résilients.
Mardi 3 février 2026

09h05 - 09h30
Dévoilement de la dimensionnalité MOSH et MOAH par des techniques
chromatographiques multidimensionnelles
Giorgia PURCARO - Gembloux Agro-Bio Tech, Université de Liège /Belgique
En savoir plus
Les hydrocarbures d'huiles minérales (MOH) englobent un large spectre de structures moléculaires, généralement classés en hydrocarbures saturés (MOSH) et hydrocarbures aromatiques (MOAH). D'un point de vue toxicologique, une évaluation éclairée des risques est nécessaire, reposant essentiellement sur une caractérisation structurale approfondie des constituants des MOH, notamment la longueur de la chaîne carbonée, l'étendue de la substitution alkyle, ainsi que le nombre et la configuration des cycles aromatiques.
L'approche analytique établie pour la détection des MOH est la chromatographie liquide-gaz couplée en ligne avec détection par ionisation de flamme (LC-GC-FID). Cependant, la méthodologie actuelle LC-GC-FID souffre d'une efficacité de séparation sous-optimale, limitant sa capacité à une discrimination moléculaire complète. La fiabilité analytique est également compromise par la coélution de substances interférentes, ce qui entrave la quantification et la caractérisation précises des fractions de MOH.
En revanche, la chromatographie gazeuse bidimensionnelle (GC×GC), traditionnellement réservée aux analyses de confirmation, s'est imposée comme une technique supérieure, capable de surmonter les limites intrinsèques de la LC-GC. La GC×GC offre une résolution de séparation et une élucidation structurale considérablement améliorées, s'alignant ainsi plus efficacement sur les normes analytiques définies dans le dernier avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).
Ce travail vise à souligner le rôle essentiel de la GC×GC dans l'amélioration de la compréhension analytique et toxicologique des MOH. Il se concentre sur l'évolution méthodologique de la GC×GC en combinaison avec des stratégies de préparation d'échantillons optimisées pour répondre aux exigences strictes de la caractérisation des MOH et explore son potentiel pour résoudre les contraintes analytiques actuelles et améliorer l'évaluation des risques toxicologiques dans ce domaine complexe.
09h30 - 09h55
Analyse du whisky par GCxGC sous hydrogènen
Damien STEYER - Twistaroma / France
En savoir plus
Cette communication présente une stratégie innovante de caractérisation des composés volatils dans le whisky par chromatographie bidimensionnelle GCxGC couplée à la détection par temps de vol (ToF-MS), avec extraction par SPME. L’ensemble du dispositif repose sur l’utilisation d’hydrogène comme gaz vecteur, dans une logique de chimie verte. L’objectif est double : améliorer la résolution analytique des composés volatils clés du whisky, tout en réduisant l’empreinte environnementale du processus analytique. Le protocole SPME est optimisé pour maximiser l’extraction des composés responsables du bouquet aromatique spécifique du whisky, notamment les esters, phénols, lactones et composés soufrés. La configuration GCxGC/ToF-MS permet d’obtenir des profils exhaustifs et reproductibles, tout en identifiant des traceurs olfactifs fins non détectés par des approches conventionnelles. L’utilisation de l’hydrogène, couplée à une gestion intelligente des flux analytiques, démontre la compatibilité entre performance chromatographique et durabilité. Cette étude ouvre des perspectives pour l’analyse éco-conçue de matrices aromatiques complexes, avec des applications étendues à d’autres spiritueux, extraits végétaux ou produits fermentés.
09h55 - 10h20
Rôle de la GC×GC-TOFMS dans la présélection des carburants d'aviation synthétiques durables
Ehsan ALBORZI - Translational Energy Research Center (TERC),
Université
de Sheffield / Royaume-Uni
En savoir plus
Cette présentation explique comment la GC×GC-TOFMS peut s'avérer un outil puissant pour la présélection des carburants synthétiques durables destinés à l'aviation. Grâce à un profilage chimique détaillé et à une résolution améliorée, cette technique permet d'identifier les caractéristiques compositionnelles clés, de faciliter l'évaluation de la qualité et d'accélérer l'évaluation des carburants candidats avant des tests plus approfondis. Les données issues de l'analyse GC×GC-TOFMS peuvent également être intégrées aux modèles de relations quantitatives structure-propriété (QSPR) et aux réseaux de neurones graphes (GNN) pour prédire les propriétés des carburants, simplifiant ainsi le processus de présélection.
10h20 - 10h45
Progrès dans la préparation d'échantillons sans solvant couplée à la GCMS au cours des 36 dernières années chez Entech instruments.
Dan CARDIN - Entech Instruments / Californie, États-Unis
En savoir plus
L'optimisation de l'extraction et du transfert d'échantillons vers un GCMS suit deux voies : quelques pistes pour réussir, et des centaines de pistes pour revenir à la case départ. Cette présentation résume les 36 années de développement visant à améliorer la collecte, l'extraction et le transfert quantitatifs de composés volatils et semi-volatils par GC, soit sans solvant, soit en petites quantités de solvants peu toxiques. Les canister d'échantillonnage sous vide pour la collecte des COV ont permis de mesurer de manière optimisée l'affinité/la répartition statique de divers produits chimiques sur les surfaces céramiques déposées par CVD, permettant ainsi d'optimiser les revêtements afin de minimiser les pertes de composés organiques avant leur arrivée au GC. L'effet du vide sur l'augmentation des taux de nettoyage des surfaces internes des canisters a conduit au développement de l'extraction sous vide directe d'échantillons liquides et solides, à l'aide de tubes de désorption thermique à revêtement céramique, appelés stylos sorbants, connectés à chaque flacon d'échantillon. L'extraction sous vide assistée par sorbant (VASE) et l'extraction sous vide par évaporation complète (FEVE) ont permis de transférer efficacement les produits chimiques dans le stylo sorbant pour une injection avec ou sans division dans un GCMS. Une solution de remplacement entièrement capillaire pour les pièges multi-lits garnis a également été développée. Elle améliore les performances d'extraction, tout comme les colonnes GC capillaires ont considérablement amélioré la résolution, la durabilité et la cohérence par rapport aux colonnes garnies précédentes. Des solutions individuelles et hybrides de ces nouvelles techniques seront présentées, avec des conclusions sur la situation actuelle et les perspectives d'avenir.
11h15 - 11h40
Création d'une base de données volatilomique de produits fermentés :
Analyse des COV par espace de tête dynamique combinée à une extraction
par sorption par barreau magnétique (Twister SBSE)
Maud LEMOIS - UMR SayFood, INRAE / France
En savoir plus
Les ferments offrent un potentiel d’innovation exceptionnel pour accompagner les transitions vers une alimentation plus sûre, plus saine et plus durable. Coordonné par INRAE et l’ANIA, financé à hauteur de 48,3 M€ par France 2030, le Grand Défi « Ferments du Futur » (GDFF) vise à accélérer la recherche et l’innovation dans le domaine des ferments et des aliments fermentés. Ce programme réunit des acteurs publics et privés.
Alors en développement en tant que plateforme distribuée pour le GDFF au sein de l’UMR Sayfood, MetaVolFood cherche à établir une base de données en métabolomique et volatilomique sur un large panel de produits fermentés du commerce. Ces informations permettront de disposer, à terme, d’un socle de connaissance constitué des profils métabolomiques des principaux produits fermentés actuellement commercialisés en France et d’apporter un appui lors de nouveaux projets.
Nous avons fait le choix de débuter cette base de données, par l’analyse de différents kéfirs de fruits et de lait. Des analyses en LC-Orbitrap et GC-MS ont étés effectuées. Il vous sera présenté la méthode analytique en GC-MS avec une combinaison de la Dynamique HeadSpace avec le Stir Bar Sorptive Extraction (SBSE Twister) en 2-Step Multi-Volatile Method (MVM) pour la réalisation de profils aromatiques.
11h40 - 12h05
Développement de revêtements liquides ioniques pour l'extraction par sorption par barreau magnétique et application à l'analyse non ciblée des polluants organiques émergents dans les eaux naturelles par une méthode SBSE-TD-GC–Orbitrap-HRMS
Pascal CARDINAEL - Université de Rouen / Normandie, France
En savoir plus
La surveillance de la qualité de l'environnement nécessite des mises à jour régulières des polluants, notamment émergents. L'évaluation de l'exposition environnementale constitue donc une étape cruciale pour proposer des mesures de protection adéquates. La plupart des polluants prioritaires et des contaminants émergents sont des composés semi-volatils. L'analyse non ciblée utilisant la chromatographie en phase gazeuse couplée à la thermodésorption et à la spectrométrie de masse à haute résolution (TD-GC-HRMS) avec un système Orbitrap permet d’identifier les contaminants organiques. Cette approche permet également d'augmenter considérablement le nombre de composés identifiés avec une grande fiabilité. Dans ce contexte, une nouvelle méthode d'extraction par barreaux aimantés (SBSE), utilisant des barreaux préparés avec des dépôts de liquides ioniques (Ils) , a été développée. Les liquides ioniques, sont des sels liquides à température ambiante qui se distinguent par leurs propriétés uniques, notamment une grande stabilité thermique, une faible pression de vapeur et une excellente capacité à dissoudre une large gamme de composés organiques et inorganiques. Leur utilisation doit permettre d'élargir la gamme des contaminants détectés et d'améliorer la qualité du screening non ciblé. Cette méthode a été appliquée à des eaux naturelles prélevées dans la rivière Robec, en France, et deux lacs algériens. Une comparaison entre les barreaux enrobés de Ils préparés au Laboratoire et ceux commerciaux enrobés de PDMS a montré une augmentation significative du nombre de composés détectés, accompagnée d'une augmentation notable de la surface des pics. Au total, plus de 1 072 composés ont été détectés, puis classés selon l'échelle d'identification de Miller, en utilisant divers scores (RSI, RHRMF et ΔRI). De plus, les résultats obtenus ont permis de mettre en évidence des contaminants jusque-là non identifiés.
12h05 - 12h30
Citoyens, pesticides et SBSE : une histoire de qualité de l'eau
Caterina CACCIATORI - Joint Research Centre (JRC), service scientifique interne de la Commission européenne / Ispra, Italie
En savoir plus
L’augmentation mondiale de l’utilisation des pesticides a entraîné une pollution environnementale significative, soulignant la nécessité d’un meilleur suivi de la qualité de l’eau. Une nouvelle solution associe technologie de pointe et implication communautaire, en utilisant des méthodes d’extraction et d’analyse à large spectre ainsi que la participation citoyenne pour détecter davantage de pesticides dans l’eau et répondre aux préoccupations locales. La présentation explore la pertinence des technologies d’extraction telles que l’extraction par barre d’agitation sorptive (SBSE) couplée à la chromatographie en phase gazeuse avec spectrométrie de masse haute résolution à temps de vol quadripolaire (GC-QToF-HRMS) pour la détection des pesticides et la surveillance basée sur la science citoyenne. Un exemple concret de cette approche est l’initiative « Les Joyaux de l’Eau » du Centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne.
Grâce à la collaboration, les communautés identifient les problèmes de qualité de l’eau, conçoivent les sites d’échantillonnage et participent à la collecte et à l’extraction des échantillons. Les méthodes de criblage du laboratoire de l’eau du CCR peuvent évaluer jusqu’à 400 agrochimiques. Nous présentons des études de cas en Roumanie, Bulgarie, Kenya, Costa Rica et Australie, en discutant des succès et des défis liés à la mise en œuvre de cette initiative.
14h00 - 14h25
Évolution générale des techniques d'analyse dans un laboratoire d'exploitation d'eau au cours des dernières années, vers un laboratoire vert
María José FARRÉ - Agbar / Espagne
En savoir plus
Afin de minimiser notre impact environnemental, nous avons mis en œuvre des changements et des améliorations significatives ces dernières années, transformant nos techniques d'analyse et nos processus de laboratoire. Ces mesures témoignent de notre engagement à devenir un laboratoire vert.
Cela signifie que nous avons adapté nos méthodes d'analyse en y apportant les modifications nécessaires, ou que nous les avons remplacées par des méthodologies alternatives qui nous ont permis de minimiser la quantité de déchets dangereux générés, qui doivent ensuite être gérés et traités correctement. Ces changements ont toujours été conformes à la réglementation en vigueur.
L'élimination ou la limitation de l'utilisation de certains produits chimiques et la révision des procédés de nettoyage des matériaux utilisés dans les méthodes d'analyse ont également contribué à la réduction de la quantité de déchets dangereux générés.
Un autre axe de travail développé ces dernières années est la numérisation des processus de laboratoire, qui automatise l'envoi des résultats des instruments d'analyse au gestionnaire de données du laboratoire (LIMS), éliminant ainsi tous les enregistrements papier primaires et améliorant la traçabilité des données. De plus, toutes les opérations de gestion des stocks et de maintenance des équipements d'analyse du laboratoire sont gérées numériquement.
Tous ces changements ont été essentiels au maintien de nos certifications de référence et de notre accréditation selon la norme internationale ISO 17025, garantissant ainsi le respect de toutes les exigences légales. Ainsi, le laboratoire d'Aigües de Barcelona s'affirme comme un centre de référence de premier plan, dédié à la protection de l'environnement et engagé dans un modèle de laboratoire vert intégrant des pratiques durables à toutes ses opérations.
14h25 - 14h50
Authentification de l'origine des ingrédients naturels en cosmétique et parfumerie
Aurélien CUCHET - L’Oréal / France
En savoir plus
L'utilisation de matières premières d'origine naturelle connaît une croissance rapide dans l'industrie cosmétique. Ce verdissement du portefeuille s'accompagne de nouveaux défis de contrôle pour garantir l'origine et le caractère renouvelable de ces ingrédients naturels. Cette traçabilité est essentielle pour vérifier l'authenticité des produits sur un marché où la fraude est courante et parfois extrêmement sophistiquée. Certains fournisseurs ont recours à l'adultération pour réduire les coûts de production, améliorer la qualité de leurs ingrédients ou augmenter artificiellement les volumes de production en ajoutant des produits moins coûteux, notamment des matières naturelles moins chères, des molécules d'origine pétrochimique ou la dilution par solvant.
Pour vérifier la présence d'adultération, des méthodes d'authentification appropriées sont nécessaires pour contrôler la naturalité et la pureté des échantillons. Les principales stratégies analytiques comprennent la recherche de marqueurs d'adultération spécifiques par GC-FID/MS ou GCxGC complet ; la signature énantiomérique par GC multidimensionnel (Heart Cutting Mode) ; la mesure des rapports isotopiques stables par IRMS couplée (EA-C/P-IRMS ou GC-C/P-IRMS) ; et la détermination du caractère renouvelable par la mesure de l'activité radiocarbone.
Le contrôle de ces produits naturels nécessite la constitution de bases de données, constituées d'échantillons parfaitement tracés pour garantir l'authenticité de leurs origines, et l'utilisation d'outils chimiométriques. La méthodologie mise en œuvre a permis de développer de nouveaux outils pertinents pour l'authentification des ingrédients naturels en cosmétique et en parfumerie.
14h50 - 15h15
VASE™ et Flash-VASE™ : les nouvelles références incontournables pour l’extraction des composés volatils et semi-volatils en chimie analytique
Dalel RACLOT - Revolab / France
En savoir plus
Dans un contexte industriel et environnemental marqué par la nécessité de développer des
méthodes analytiques plus durables, plus rapides et plus sensibles, le VASE™ (Vacuum Assisted
Sorbent Extraction) et le Flash-VASE™ émergent comme des technologies clés pour l’analyse des
composés volatils et semi-volatils.
Basées sur une extraction sous vide sans solvant, ces approches s’inscrivent pleinement dans les
principes de la « green analytical chemistry », en supprimant ou réduisant significativement la
consommation de solvants, l’énergie analytique globale et la production de déchets, tout en
améliorant les performances métrologiques. Le VASE™ permet une extraction exhaustive et
reproductible, et le Flash-VASE™ permet d’aborder des matrices plus complexes comme les
plastiques, les matériaux ou les huiles.
REVOLAB se propose de présenter des applications récentes et à fort impact du VASE™ et du Flash-
VASE™ dans des domaines d’intérêt commun aux laboratoires académiques et industriels :
- surveillance environnementale des COV et SCOV dans l’air, l’eau, les sols, les plantes
(écologie chimique)
- analyse d’émissions et de relargage de matériaux, polymères et produits de consommation,
- caractérisation des arômes, odeurs et marqueurs de qualité dans les matrices alimentaires
ou cosmétiques
- détection de contaminants traces et de composés émergents.
Les performances analytiques seront discutées à travers des comparaisons critiques avec les
techniques conventionnelles (SPME, headspace, purge & trap), mettant en évidence les gains en
sensibilité, temps d’analyse, robustesse et empreinte environnementale.
Enfin, les perspectives de standardisation, d’automatisation et d’intégration dans des workflows
analytiques durables seront abordées, soulignant pourquoi le VASE™ et le Flash-VASE™ constituent
aujourd’hui des leviers concrets pour la transition écologique des laboratoires de chimie analytique,
tant académiques qu’industriels.
14h50 - 15h15
Diagnostic territorial des microplastiques des eaux usées à l'eau potable
Lauriane BARRITAUD - Veolia DEST (Direction des Expertises Scientifiques et Techniques) / France
En savoir plus
Deux études complémentaires menées par VEOLIA ont examiné la contamination des milieux aquatiques par les microplastiques (MP). Le projet MEDITPLAST (2019-2024) a étudié la baie de Toulon et analysé les résidus de pneus (RT) de MP dans diverses matrices d'eau (eaux pluviales, eaux usées brutes, eaux usées traitées…) à l'aide de dispositifs d'échantillonnage UFO spécifiques pour les MP dans des matrices complexes et de techniques avancées d'imagerie FT-IR. Les résultats ont montré que les stations d'épuration atteignent une efficacité d'élimination des MP et des RT pouvant atteindre 99,9 %, les résidus de pneus représentant jusqu'à 98 % de la contamination des eaux pluviales. Étonnamment, les eaux pluviales, et non les eaux usées traitées, ont été la principale source de rejet de MP/RT dans la baie.
Une étude parallèle portant sur deux stations d'épuration françaises utilisant des eaux souterraines a utilisé un système de filtration dédié (STORM) développé par Veolia pour prélever de grands volumes d'eau potable (> 500 L) sur des filtres en acier inoxydable de 5 µm. Les résultats ont révélé de faibles concentrations de PM dans les eaux souterraines et l'eau potable (< 1 PM/L pour les particules > 6,6 µm), les eaux souterraines influencées par les rivières présentant une contamination plus élevée (2 PM/L) que les sources protégées (0,3 PM/L). Les deux études soulignent la grande efficacité des procédés de traitement de l'eau et soulignent la nécessité d'harmoniser les protocoles d'analyse pour mieux comprendre les schémas mondiaux de contamination par les PM.
Ces études ont été réalisées en collaboration avec l'Université d'Aalborg (Jeff Vollertsen).
15h45 - 16h10
16h10 - 16h35